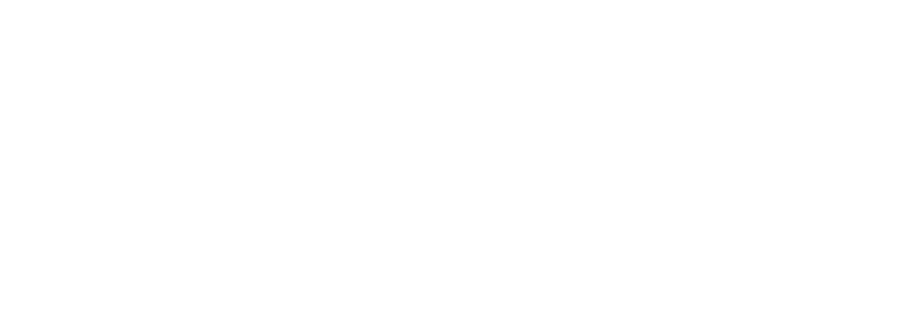En août 2005, la Suisse a connu l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices de son histoire récente. De fortes pluies persistantes ont fait déborder des rivières et des ruisseaux, des pentes ont glissé, des routes ont été emportées et des localités entières ont été dévastées. L'Oberland bernois, la Suisse centrale et le Valais ont été particulièrement touchés. Les dégâts se sont élevés à plusieurs milliards de francs. Pour les assureurs, la crue du siècle a été un cri d'alarme. Pour la Mobilière, ancrée dans le système coopératif, elle a marqué le début de l'un de ses principaux engagements sociaux.
Depuis 2006, la Mobilière s'engage pour la protection contre les dangers naturels. Jusqu'à présent, elle a soutenu financièrement plus de 180 projets de prévention. Plus de 46 millions de francs ont été investis à cet effet. L'idée est simple: chaque franc investi dans la prévention permet d'économiser cinq à sept francs de dommages en cas d'urgence. Parallèlement, des zones de détente et des espaces de vie proches de l'état naturel sont créés en de nombreux endroits.
L'année 2005 a clairement montré à quel point les infrastructures sont vulnérables. Des quartiers entiers ont été inondés, des liaisons de transport interrompues, des personnes ont dû être évacuées. Les dégâts n'ont pas seulement touché les particuliers, mais aussi les pouvoirs publics et les entreprises. Il est devenu clair que la prévention doit devenir une tâche stratégique. Les mesures de construction ne suffisent pas. La recherche, la sensibilisation, la prévention au niveau des objets et une meilleure planification d'urgence sont également décisives.
Outils d'évaluation des risques
Le Mobiliar Lab pour les risques naturels, créé en 2013 en collaboration avec l'Université de Berne, joue un rôle central dans cette stratégie. Il développe des outils scientifiquement fondés pour l'évaluation des risques, par exemple sur le déroulement d'un événement de crue ou sur la relation entre le débit et les dommages attendus de tronçons de rivière. Les connaissances ainsi acquises sont directement intégrées dans la planification et la mise en œuvre des mesures de protection.
A Delémont par exemple, la capitale du canton du Jura, le projet "Marée basse" a posé les jalons d'une meilleure protection. La ville a été touchée à plusieurs reprises par des inondations. La solution choisie a été d'abaisser de manière contrôlée le niveau de la rivière en cas de fortes pluies. Cela permet de réduire de manière significative le risque d'inondation pour le centre de la ville, sans pour autant obstruer la rivière. Cette mesure ne protège pas seulement, elle améliore également le paysage urbain.
Un autre exemple est celui de la commune obwaldienne d'Alpnach: Le long de la Kleine Schliere, on construit notamment un corridor de délestage et un ouvrage de décharge qui permettront d'évacuer les masses d'eau en cas de fortes pluies. A Wilderswil, dans l'Oberland bernois, un site touristique très apprécié, un concept global de protection contre les inondations a été mis en œuvre. De nouvelles digues, des bassins de rétention et des renaturations réduisent considérablement le risque d'inondation, y compris pour les infrastructures touristiques importantes. Ces mesures montrent que protection et développement régional peuvent aller de pair.
La commune argovienne de Freienwil a opté pour une approche écologique: des zones de rétention ont été créées, les cours d'eau ont été renaturés et l'eau a retrouvé son espace. Le résultat: un environnement proche de la nature, qui assure en même temps la sécurité. La population locale a été impliquée dans le projet, ce qui a été un facteur de réussite pour son acceptation.
Aujourd'hui, la Mobilière va encore plus loin dans son engagement. Face au changement climatique, les simples mesures de protection ne suffisent plus. Il s'agira à l'avenir d'aménager des zones d'habitation plus résilientes au climat. On comprend aujourd'hui qu'en raison du réchauffement, les fortes précipitations décentralisées et de courte durée s'intensifient. L'eau qui s'écoule en surface provoque ainsi davantage de dégâts. Les villes-éponges constituent une mesure centrale pour y remédier. Les places et les rues sont aménagées de manière à pouvoir stocker l'eau et la restituer avec un certain retard. Cela réduit les dégâts dus aux inondations et a en même temps un effet rafraîchissant sur le microclimat en raison de l'évaporation. Les principes de la ville éponge s'appliquent par exemple aux places d'écoles, aux îlots de circulation ou aux installations publiques. Les surfaces imperméabilisées sont désensablées, des plantes sont plantées et des dépressions sont aménagées. Le risque de ruissellement de surface diminue et la qualité de séjour augmente.
Planification basée sur des données - prévention mesurable
À l'aide de l'outil "Dynamique des crues" développé par le Mobiliar Lab pour les risques naturels, il est aujourd'hui possible de simuler différents scénarios d'inondation extrêmes, mais physiquement plausibles, ainsi que leurs conséquences. Cela permet d'anticiper les risques d'inondation et d'aborder les événements extrêmes avant qu'ils ne se produisent. L'outil "Sensibilité aux risques" montre pour l'ensemble de la Suisse, pour les grands cours d'eau et les lacs, à partir de quels débits les dommages augmentent brusquement. Ces bases permettent de rendre imaginables des événements jusqu'ici impensables et d'identifier les points névralgiques de la prévention des inondations.
Willisau est un exemple impressionnant de planification intégrée: après la crue centennale de 2005, le ruisseau de la ville a été mis à ciel ouvert et réaménagé. Il en est résulté non seulement un système de protection fonctionnel, mais aussi un espace public attractif avec une qualité de séjour. La prévention des inondations est devenue le moteur du développement urbain. De telles approches le montrent: La prévention n'est pas seulement utile, elle est aussi esthétique. Lorsque les mesures de protection sont planifiées de manière intelligente, de nouveaux espaces voient le jour, qui allient sécurité, qualité de vie et durabilité.
Systèmes de protection mobiles et formations
Lorsque des mesures de construction permanentes ne sont pas réalisables, la Mobilière mise également sur des solutions rapidement utilisables. Les communes particulièrement menacées reçoivent des systèmes mobiles de protection contre les inondations, qui sont stockés dans un conteneur et peuvent être installés rapidement en cas d'événement. Les dommages peuvent ainsi être évités à court terme, notamment dans les zones urbaines où la place manque généralement pour des systèmes de protection construits à grande échelle. Parallèlement, on investit dans la sensibilisation: Le Mobiliar Lab développe, en collaboration avec des partenaires comme l'Université de Berne, des formations et du matériel pour les forces d'intervention, les autorités et la population. L'objectif est de renforcer la conscience des risques et d'encourager la responsabilité individuelle.
La crue centennale de 2005 a été un choc. Mais aussi un appel au réveil pour investir de manière conséquente dans l'avenir, comme le montre l'exemple de la Mobilière: dans les ouvrages de protection, dans la science, dans la coopération locale et dans la capacité de résistance de lotissements entiers. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, la Suisse est nettement mieux préparée à de tels événements naturels grâce à ces efforts. Mais le changement climatique se poursuit, entraînant une augmentation des conditions météorologiques extrêmes et des risques qui y sont liés. La prévention, la résilience et l'innovation restent nécessaires pour que la Suisse soit prête à affronter les prochains événements extrêmes.